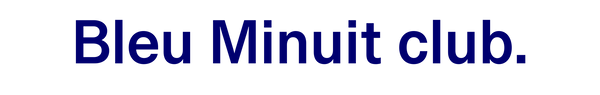Rick Owens, figure majeure de la mode contemporaine, s’est imposé ces dernières années par une esthétique à la fois punk, radicale, brutale et étrangement glamour. À l’opposé en apparence, Gustave Moreau, peintre symboliste du XIXᵉ siècle, explore un univers fait de rêve, de mystère et de suggestion plutôt que de réel. Deux univers, deux langages, deux époques qu’à première vue tout oppose. Pourtant, leur dialogue visuel fonctionne avec une évidence presque troublante.
J’ai commencé à faire ce parallèle à la suite de ma visite au Palais Galliera, en juin 2025, à l’occasion de l’exposition Temple of Love, rétrospective dédiée au designer américain Rick Owens. Au détour des silhouettes sombres et sculpturales, une surprise : quatre tableaux du XIXᵉ siècle accrochés parmi les vêtements. Les œuvres, signées Gustave Moreau, représentaient Salomé dansant devant Hérode, un motif que l’on croirait à mille lieues du vestiaire gothique et brutaliste d’Owens, mais qui, en réalité, en éclaire la profondeur.
Mais avant d’observer ce rapprochement, revenons-en à celui qui l’inspire, à ce maître de la peinture de la seconde moitié du XIXe siècle qui a marqué à lui seul des générations d’artistes : Gustave Moreau. Figure majeure du symbolisme, il s’est toujours tenu à la marge des courants de son temps. Il choisissait d’explorer l’imaginaire, le rêve, le sacré plutôt que la réalité. Ses toiles ne racontent pas le monde visible, mais les profondeurs de l’âme et les mythes qui la hantent. Dans son atelier parisien, aujourd’hui devenu musée, Moreau a peint des centaines d’images peuplées de créatures bibliques et de héros mythologiques. Ses figures féminines y apparaissent comme des apparitions ambiguës, à la fois sublimes et menaçantes. Chez lui, la femme incarne souvent la beauté absolue, mais aussi le danger de la fascination. L’une de ces figures les célèbres et qui incarne le mieux son univers est Salomé. Inspirée de l’épisode biblique raconté dans l’Évangile selon Saint Marc, elle est la jeune fille qui, après avoir dansé devant le roi Hérode, obtient en récompense la tête de Jean-Baptiste. Elle représente la beauté menaçante. Elle fascine parce qu’elle incarne une forme de transgression, celle d’un corps qui séduit et d’un regard qui détruit.

Cette ambiguïté, qui mêle pureté et perversion, est au cœur de ce que Joris-Karl Huysmans appellera dans son roman À rebours la « décadence » : une recherche de beauté pure poussée jusqu’à l’excès. Chez Moreau, Salomé devient le miroir de cette tension. Elle est à la fois beauté céleste et figure du mal. Owens a lu ce manifeste de la décadence et en parle souvent comme d’une révélation. Chez Huysmans, il retrouve cette fascination pour la beauté rare et excessive, une beauté qui n’apaise pas, mais trouble. C’est dans ce roman qu’apparaît la célèbre description de la Salomé de Moreau, érigée en icône de la décadence. Elle est décrite en femme fatale, à la fois sainte et meurtrière, incarnation du désir et du danger. Cette figure hante toute la culture de la fin du XIXe siècle, et Owens s’y reconnaît pour ce qu’elle dit du rapport au corps, au sacré et surtout à la transgression. Rick Owens, lui aussi, cherche un idéal de beauté qui échappe aux normes. Dans ses silhouettes longues, drapées ou gainées de cuir, il célèbre une forme de sensualité mystique, où le corps devient presque une relique (ce que l’exposition du Palais Galliera met particulièrement bien en scène). Comme chez Huysmans, la beauté n’est jamais confortable, elle isole, elle élève, elle dérange. Lire Huysmans, c’est pour lui renouer avec une esthétique de la décadence assumée, où l’art se fait refuge face à la vulgarité du monde moderne. Mais c’est aussi comprendre Moreau autrement. Non plus comme un peintre du passé, mais comme un précurseur de cette beauté alternative, baroque et spirituelle, que la mode d’Owens prolonge aujourd’hui sur les podiums.
Pour en revenir à l’exposition Temple of Love et à des exemples plus concrets du travail de Rick Owens, voici ce que révèle le parcours au sein des salles du Palais Galliera. Autour des études préparatoires de Salomé dansant devant Hérode, deux ensembles de silhouettes sont présentés côte à côte. D’un côté, des drapés couleur chair, beige et terre, glissent sur les mannequins comme une seconde peau. Les tissus, fluides et légèrement transparents, rappellent la souplesse des étoffes antiques et évoquent les mouvements d’une danse, ceux-là mêmes que Moreau immortalise dans sa Salomé. Owens y projette une sensualité maîtrisée, retenue, où le vêtement enveloppe le corps plutôt que de l’exposer. Les corps sont dessinés, mais jamais dévoilés, pris dans un équilibre entre pureté et tentation. À côté, un second ensemble tranche par sa noirceur. Le cuir et les matières plus denses dominent. Les vestes se structurent, les jupes s’allongent, et la rigueur des coupes remplace la mollesse des drapés. On passe du mythe biblique à l’icône moderne, d’une Salomé extatique à une figure presque guerrière. Ces vêtements, par leur sobriété dramatique, prolongent la tension des toiles, celle d’un érotisme sublimé par la retenue, d’une beauté qui séduit parce qu’elle résiste. Entre les deux mondes, celui de Moreau et celui d’Owens, s’installe un même culte du beau étrange, de la grâce enténébrée.


Ce rapprochement entre Moreau et Owens ne tient pas seulement à une affinité esthétique, mais à une même conception du beau, un beau qui dérange et s’émancipe des canons établis. Chez Gustave Moreau, la beauté est mystique et inquiétante. Ses figures féminines fascinent et incarnent une idée du sublime qui se nourrit d’excès, de spiritualité et de désir. Salomé, en particulier, résume cette tension, elle est à la fois pure et perverse, sacrée et profane, beauté et destruction. Rick Owens, un siècle plus tard, prolonge ce questionnement à travers le langage de la mode. Ses silhouettes longilignes, ses drapés lourds et ses modèles volontairement hors des normes proposent une alternative radicale aux standards de beauté dominants. Il s’intéresse aux marges, à la fragilité, à la monstruosité même du corps. Comme Moreau, il cherche à réconcilier le sublime et le dérangeant, à redonner au beau une part de mystère. « J’adore le symbolisme, la lourdeur de ses couches épaisses et son côté mélodramatique», confie-t-il dans une interview, un aveu qui éclaire sa fascination pour la lenteur, la gravité et la théâtralité du geste créatif. Owens, à l’instar de Moreau, ne cherche pas à plaire mais à révéler. Ses mannequins, figés devant les toiles du peintre, semblent des incarnations modernes de Salomé, des corps sculptés par la lumière. Chez l’un comme chez l’autre, l’art est un lieu de résistance à la banalité, un moyen de renouveler le regard porté sur le beau et de le libérer de toute complaisance.
Un autre parallèle que l’on pourrait faire entre les deux artistes serait de l’ordre du mythe qui, chez les deux, paraît être une source d’inspiration inépuisable. Tous deux puisent dans les récits anciens, bibliques, grecs ou orientaux, non pour les illustrer, mais pour les réinventer. Chez Moreau, le mythe devient un miroir intérieur qui ne raconte plus un événement, mais un état de l’âme. Ses figures, qu’il s’agisse de Salomé ou de Léda, ne sont pas des héroïnes de chair mais des allégories, des symboles du désir ou de la perdition. Rick Owens partage cette démarche. Dans ses défilés comme dans ses installations, les références mythologiques structurent une réflexion sur le corps et le pouvoir. Ses silhouettes longues et hiératiques rappellent les prêtresses ou les figures tragiques de l’Antiquité. La mode devient un rituel, le vêtement un totem. Owens ne cite pas littéralement les mythes mais en retient l’essence, la monumentalité et la charge symbolique du geste. Comme chez Moreau, le corps est sacralisé, détaché du réel, placé dans une temporalité suspendue. Ainsi, la mythologie offre un espace où la beauté, l’étrange et le spirituel cohabitent, un espace que tous deux habitent, chacun à leur manière, comme des architectes du sublime. Là où le peintre convoque les mythes bibliques et les légendes orientales pour échapper au réalisme, le créateur américain puise dans ces mêmes imaginaires pour s’opposer à la mode jetable et standardisée. Les deux artistes construisent des mondes refermés sur eux-mêmes, faits de symboles. Chez l’un comme chez l’autre, le décor, le vêtement ou le bijou ne sont pas de simples ornements mais deviennent des langages spirituels, des parures de l’âme.
Ce qui se joue entre Gustave Moreau et Rick Owens dépasse la simple influence. C’est une véritable continuité de langage, d’un médium à l’autre, de la peinture au vêtement. Chez Moreau, la peinture ne décrit pas une scène réelle, elle construit une vision à travers les drapés, les lumières, la posture du corps. Chez Owens, on retrouve exactement la même logique : les matières, les coupes et les longueurs servent à composer une apparition, presque comme si chaque silhouette était un tableau en mouvement. La mode devient ainsi, comme la peinture, une surface de pensée.
Tous deux partagent une fascination pour le sacré et le corps. Un corps à la fois exalté et contenu, à la limite du profane. En juxtaposant leurs œuvres, le Palais Galliera révèle que la mode peut prolonger la peinture symboliste sans la répéter. Dans l’exposition, le vêtement d’Owens n’illustre pas Moreau mais le continue. La mode y est traitée comme une peinture en trois dimensions. Owens réinterprète le mysticisme de Moreau dans une grammaire contemporaine, celle du cuir, du drapé, du noir. Là où le peintre voyait dans la parure un signe spirituel, le créateur en fait une armure pour l’individu moderne, un moyen de se soustraire au conformisme et de retrouver, dans l’étrangeté, une forme de foi esthétique.