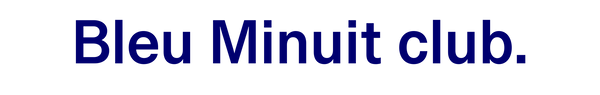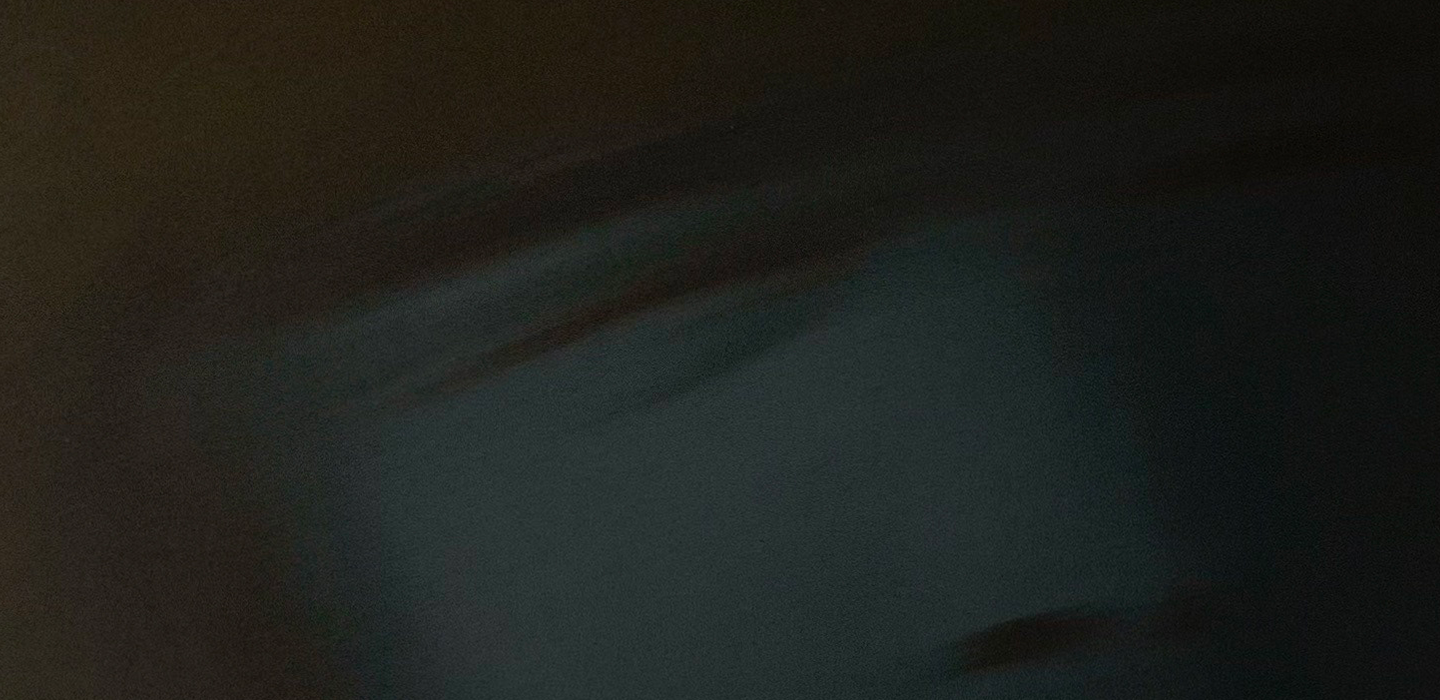
J’ai découvert pour la première fois la peinture de Julien Heintz en mars 2025 lors de ma visite de « L'Art et la vie et inversement ». C'était le titre donné à l’exposition des travaux des vingt-six artistes ayant obtenu le Diplôme National Supérieur d'Arts Plastiques des Beaux-Arts de Paris avec les Félicitations du Jury. L’exposition, sous le commissariat d’Anaël Pigeat, portait, au travers d’un large éventail de médiums et de thématiques, la vision de cette nouvelle génération d'artistes sur le monde actuel, et donc les échanges possibles entre l’art et la vie dans son sens le plus large. Un dialogue ouvert sur le sens du progrès, l’héritage et la mémoire collective, sur les doutes et les menaces qui planent sur notre monde, mais aussi sur la valeur de l'humanité.
Julien Heintz présentait, si ma mémoire est bonne, trois tableaux. Dans mes notes iPhone du 2 mars je décris l’un d'entre eux :
« Je me retrouve maintenant face à une brume, un écran de fumée, un nuage dans un nuancier de beiges. J’ai le sentiment que l’on cherche à me perdre, à brouiller les pistes, que l’on me cache quelque chose. Pourtant, derrière ce flou, je distingue paradoxalement nettement un visage. C’est comme si j’avais fermé les paupières pour l’imaginer, ou que je cherchais à me le remémorer à partir d’un rêve ou d’un souvenir. Le visage peint est celui d’un homme, à l’allure sévère et militaire, dont j'ignore l'identité. Le regard, peut-être inquiet, est fuyant et porté sur autre chose ; malgré cela, il attire mon attention. »
Il est clair que ce que je viens de voir m’intrigue.
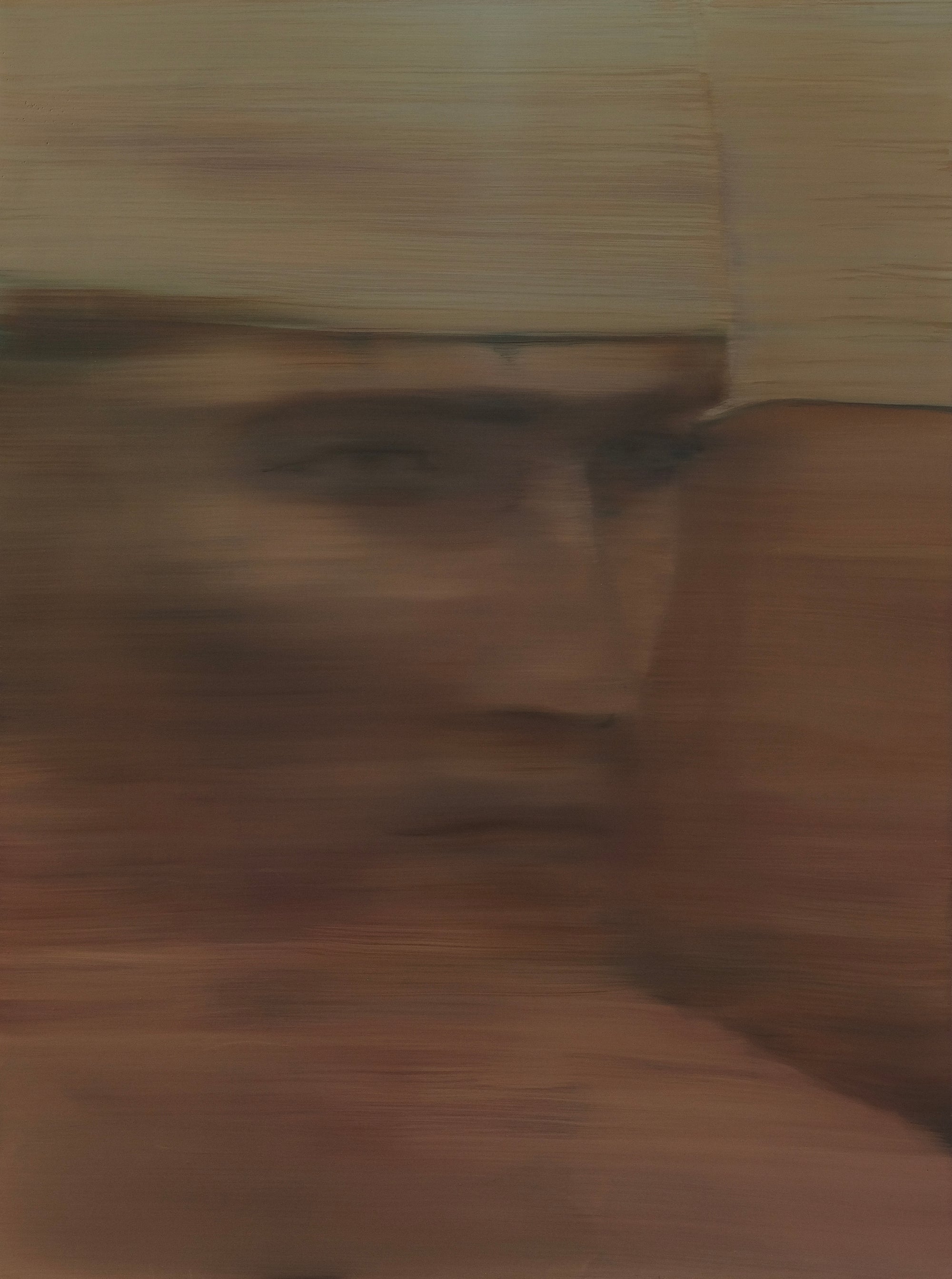
Après quelques recherches, j’ai pu retrouver l'œuvre en question, intitulée en réalité : « Deux liquidateurs de Tchernobyl en 1986 ». Sont appelés « liquidateurs » tous les civils et militaires mobilisés par l'Union soviétique après l'explosion pour contenir la catastrophe, décontaminer la zone et construire le sarcophage. Le titre est donc la clé de compréhension centrale de l'œuvre : l’individu n’est plus ; il n’est question que de sa fonction, de son utilité, de son passage dans l’histoire. L’exercice de lecture d’un portrait est complètement redéfini. Le lien entre le sujet et son observateur est obstrué et impersonnel ; nous nous tenons face à un spectre de notre Histoire.
Pour peindre, Julien Heintz s’appuie sur une iconographie qu’il élabore lui-même en capturant des images ou des extraits vidéo sur des événements qu’il détermine comme charnières. Il développe un éclectisme radical, puisant dans un spectre de sources extrêmement vaste, allant du film documentaire à la publicité, en passant aussi par le cinéma. (Il réalise d’ailleurs en 2024 un génial tableau titré « Annalee call, Alien 4 ».) Un éclectisme qui se reflète également dans ses influences. Dans une interview accordée à la galeriste Elsa Meunier, il tisse ainsi, à travers ses références, des ponts entre l'abstraction chromatique (Rothko, Hodgkin, Twombly, Reigl), la figure spectrale (Spilliaert) et un certain onirisme cinématographique (Lynch, Villeneuve, Tarkovski…). Mais derrière ce syncrétisme et la citation de ceux que l’on pourrait nommer comme les néo-maîtres de la peinture contemporaine, au côté de Baselitz ou Bacon, Julien Heintz élève ce processus de sourçage visuel au rang de structure fondatrice dans sa démarche picturale.
Pour sa dernière exposition Residual Moments, présentée il y a quelques semaines à la galerie Mennour, son iconographie est uniquement constituée d’extraits vidéo de 4 à 15 secondes. La notion d'instant, de temporalité, est donc essentielle et remplace la notion d’individualité, traditionnellement associée au portrait. En l'absence de repères individuels forts, et confronté à un titre factuel qui ne donne qu'un instantané historique, le spectateur engage un travail d'identification et de mémoire active. Il se met malgré lui en dialogue avec l'inconnu, et c'est dans ce face-à-face que réside toute la force de l'œuvre. Mais l'épais voile de brume qui caractérise ses figures n'est pas apparu soudainement ; il s'est progressivement élaboré au fil de ses expositions, révélant une quête continue de l'effacement.

En 2022, la commissaire Esme Blair et Julien Heintz présentent pour sa première exposition personnelle en galerie « Spectres of Memory » chez Pal Project. Dans le titre, on devine que la notion spectrale de son travail est centrale. Mais qu’est-ce que ça veut dire concrètement ?
Ici et là, un brouillard aqueux se lève et voile ce qui semble être des visages ou des corps. Globalement, hormis quelques écarts sur la biodiversité marine (sublime d’ailleurs), l'ensemble honore le principe central du portrait en figurant les traits physiques d'un individu. Mais le sujet, lui, est déjà anonymisé au profit de sa fonction et d’une vague date. On ne peut que deviner alors s'il s’agit de généraux ou de soldats. Il faut préciser aussi que l’exposition est fortement imprégnée par l’Histoire du XXe siècle.
En lisant son entretien avec la commissaire, j’apprends que Julien se définit en 2022 comme « un peintre abstrait utilisant des images figuratives ». Une vision mixte de la peinture, dans la continuité de réflexions entreprises par certaines de ses références. On pourrait définir cette approche picturale comme la fusion d’une représentation du monde réel avec l'autonomie formelle de la couleur et du geste. Ici, Julien Heintz étire, déforme ses modèles, comme aspirés par la toile et le temps. Les couleurs, elles, sont lourdes et renvoient à un imaginaire fantomatique. On frôle le monochrome. Néanmoins rien n’est statique, la toile témoigne déjà d’un certain mouvement ! Bien que le sujet se nourrisse d’un événement historique, il ne semble en rien figé dans une temporalité. La lecture semble multidimensionnelle, en bref : c’est au regardeur de décoder ce qu’il voit et de construire sa propre temporalité. Un rapport actif entre le spectateur et l'œuvre, qui provient, je pense, de son goût marqué pour Mark Rothko. Pour revenir à lui, cet épisode marque le point de départ essentiel de l'œuvre à venir de Julien Heintz.
En 2024, la galerie Pal Project l’accueille à nouveau avec une exposition personnelle intitulée « L'Anonyme comme médium ». Enveloppé du même aspect brumeux et dans la continuité de Spectres of Memory, l'artiste repousse cette fois notre rapport à l'anonymat. Alors, comme il le dit lui-même, comment peindre cet anonyme ?
Sur la toile, le voile s'est épaissi sur les visages, dont il ne reste plus que l'architecture. Aucun regard (que l'on appelle le miroir de l'âme) ne perce jusqu'à nous. Je distingue clairement une figure, mais je ne vois personne. Pourtant, son travail prend toujours comme point de départ de courts extraits vidéo ou des captures d’écran de documentaires historiques ou de films. La source est donc restée objective ; néanmoins, hormis le titre ou un détail comme une étoile rouge ou un casque militaire glissé dans l'œuvre, celle-ci est entièrement détachée de son contexte. Chaque individu représenté n’existe plus que par son appartenance à un corps, un ensemble de personnes.
Vous vous dites sans doute que l'imaginaire convoqué, bien qu'issu de sources variées, est en réalité principalement teinté de violence et de tragédies liées aux conflits armés. Il est vrai que son œuvre et donc mon article se concentrent principalement sur ces événements.
Personnellement je pense que la violence est indissociable de la notion de mémoire du siècle dernier, celui-ci peut-être plus que les précédents, car la violence s’y est industrialisée. Cette violence est devenue technologique, globale, idéologique et systémique. L’art est par nature en relation avec les valeurs de la société dans laquelle il évolue, et au XXe siècle l'art est indissociable des conflits armés : même les mouvements les plus naïfs tels que l'art brut sont des tentatives de réparer l'histoire en retrouvant une expression humaine fondamentale.
L'art contemporain ne peut contourner ces questions, car il se doit, peut-être plus que jamais, de dénoncer, commémorer et représenter l'horreur des limites humaines dépassées. Un ultime parallèle avec la peinture de Mark Rothko est d’ailleurs encore possible. Rothko affirmait que « l’expérience tragique est la seule référence de l’art ». D’après lui, l’essence de l’art réside tant dans sa capacité à représenter l'extase que l’abomination, la mémoire de l’humain universel. Pourtant il n’a jamais représenté frontalement une quelconque horreur.

Julien Heintz, lui, développe une approche collective de la mémoire. Dans sa peinture, il utilise l’anonymat et choisit des sujets extrêmement variés. Il n’est jamais en vérité question de camps ou de conflits ; de cette histoire, il ne reste que des morceaux, des victimes devenus spectres. D’ailleurs, c'est comme si ces anonymes et leurs souvenirs s’apprêtaient à disparaître. Je dirais alors qu’il s’instaure paradoxalement une urgence, celle de saisir face à l'œuvre son propre reflet dans l’inconnu qui lui fait face. Le spectateur est donc invité à sonder sa propre mémoire, et à façonner lui-même les leçons de ces spectres avant qu’ils ne s’évaporent.
Megan Macnaughton tisse d’ailleurs un lien entre la dernière série de Julien avec la dernière phrase de l’étude de Jean-Paul Sartre, Les Mots : « Tout un homme, fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n’importe qui. » Une déclaration d'universalisme humaniste et d'égalité fondamentale qui entre parfaitement en résonance avec le discours du peintre.
Dans cette dernière exposition, il y dévoile une nouvelle série d'huiles sur toiles et de pastels sur papier. Je crois que nous devons aussi nous concentrer sur un aspect purement matériel de son travail. Julien fabrique lui-même ses propres toiles. Il recouvre sa peinture à l’huile d’un mélange de colle de peau et de poudre de marbre, mélange qu’il vient ensuite poncer pour créer une surface lisse et fine, proche du marbre lui-même. Outre l’aspect artisanal, cette pratique, par les reflets de la lumière, l’effet miroir de la toile, et peut-être aussi la symbolique du marbre profondément liée à l'éternité, vient renforcer son discours.
Le titre de la série « Residual Moments » marque un ultime tournant dans cette logique. Et dévoile ce qui semble être l'ultime message qui se cache derrière ces brumes. Un moment résiduel désigne la trace persistante, c'est-à-dire ce qui reste du passé dans le présent. La définition officielle englobe les vestiges matériels comme immatériels, moraux et émotionnels. Bref : il n'est plus question du passé ici mais plutôt de ce qu’il en reste dans notre présent. L'exercice mémoriel lui-même est inversé. Pour comprendre l’inconnu face à nous, c'est nous que nous devons regarder, l’humanité dans son ensemble.
Toutes mes pensées vont à Julien Heintz, Pal Project et la Galerie Mennour pour leur soutien et leur collaboration.